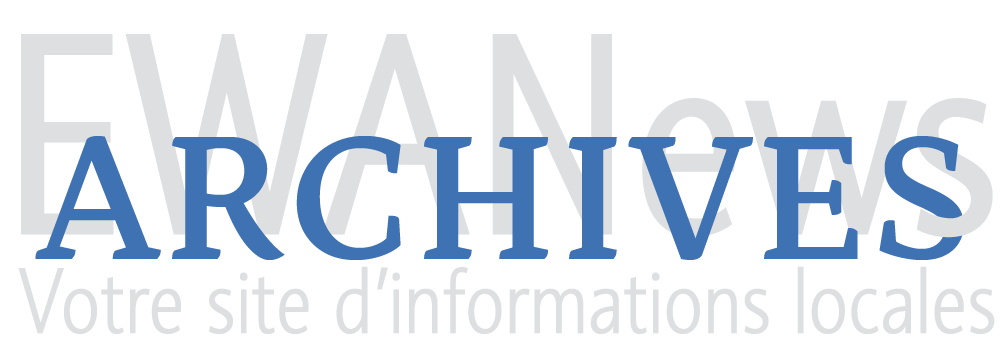La conférence-débat de l’ARES, le 28 janvier 2016, sur le thème « Héritages » était animée par le notaire honoraire Patric Chouzenoux. La soirée entrait totalement dans les fondements de l’ARES (Atelier de Réflexion Ethique et Sociale) de Bersac (Le Lardin Saint-Lazare, 24). Dans ce débat, les trois grandes lignes qui sont chères à l’ARES étaient en effet personnalisées : « se rassembler, s’asseoir et se parler » comme l’a souligné Henri Delage. « Se rassembler : ce soir, pour réfléchir et échanger sur « héritages » (qui n’est pas une consultation juridique pour tel ou tel problème de succession mais une réunion de réflexion éthique et sociale, même si elle doit s’appuyer sur du vécu). S’asseoir : se mettre en état d’écouter, de penser, d’éclairer son histoire. Se parler « et s’écouter d’une façon suffisamment bienveillante et attentive, jusqu’à être disponible à changer d’avis ». Pour ceux qui ont des questions ou des suggestions sur le cadre, l’histoire et le programme de l’ARES, nous serons disponibles, à l’issue de la réunion, pour répondre à vos questions. Nous serons disponibles, ravis, mais aussi très intéressés par vos avis » dit-il. Henri Delage signale aussi l’institution récente et prometteuse des groupes de préparation des réunions. « C’est une opportunité de grand intérêt pour le groupe. On y débat, par exemple, pour ce soir de : « héritage » ou « héritages » ? Quels héritages ? Quels sont les problèmes qui se posent ? Personnels, éthiques, universels, législatifs, sociaux… Il ne s’agit pas de faire une réunion anticipée, de répondre aux questions, mais de poser et formuler les questions. L’intérêt pour les participants ? Nous sommes victimes de notre succès et les « tours de table » hyper-intéressants à une vingtaine sont impossibles à 50. Donc, ceux qui sont intéressés, qui sont concernés, qui veulent que soit abordé tel ou tel point de vue, sont invités à ces réunions de préparation, c’est largement ouvert ».
La conférence-débat de l’ARES, le 28 janvier 2016, sur le thème « Héritages » était animée par le notaire honoraire Patric Chouzenoux. La soirée entrait totalement dans les fondements de l’ARES (Atelier de Réflexion Ethique et Sociale) de Bersac (Le Lardin Saint-Lazare, 24). Dans ce débat, les trois grandes lignes qui sont chères à l’ARES étaient en effet personnalisées : « se rassembler, s’asseoir et se parler » comme l’a souligné Henri Delage. « Se rassembler : ce soir, pour réfléchir et échanger sur « héritages » (qui n’est pas une consultation juridique pour tel ou tel problème de succession mais une réunion de réflexion éthique et sociale, même si elle doit s’appuyer sur du vécu). S’asseoir : se mettre en état d’écouter, de penser, d’éclairer son histoire. Se parler « et s’écouter d’une façon suffisamment bienveillante et attentive, jusqu’à être disponible à changer d’avis ». Pour ceux qui ont des questions ou des suggestions sur le cadre, l’histoire et le programme de l’ARES, nous serons disponibles, à l’issue de la réunion, pour répondre à vos questions. Nous serons disponibles, ravis, mais aussi très intéressés par vos avis » dit-il. Henri Delage signale aussi l’institution récente et prometteuse des groupes de préparation des réunions. « C’est une opportunité de grand intérêt pour le groupe. On y débat, par exemple, pour ce soir de : « héritage » ou « héritages » ? Quels héritages ? Quels sont les problèmes qui se posent ? Personnels, éthiques, universels, législatifs, sociaux… Il ne s’agit pas de faire une réunion anticipée, de répondre aux questions, mais de poser et formuler les questions. L’intérêt pour les participants ? Nous sommes victimes de notre succès et les « tours de table » hyper-intéressants à une vingtaine sont impossibles à 50. Donc, ceux qui sont intéressés, qui sont concernés, qui veulent que soit abordé tel ou tel point de vue, sont invités à ces réunions de préparation, c’est largement ouvert ».
Le mot « Héritage » désigne la « Transmission de quelque chose d’une génération à l’autre. Transmission du patrimoine, de ce qui est matériel. Les morts transmettent aux vivants ce qu’ils ont acquis dans leur propre vie par disposition testamentaire ou par application des lois en vigueur. Par définition, ils transmettent ce dont ils n’ont plus besoin et continuent ainsi à s’occuper de leurs enfants. D’un point de vue moral et politique, les choses sont plus complexes, car la coutume a presque partout précédé les lois. Ainsi, riches et pauvres acceptent la légitimité de l’héritage, alors qu’hériter, c’est presque toujours recevoir quelque chose qu’on n’a aucunement mérité. On peut, de ce fait, reprocher la « reproduction sociale » (rentiers de naissance, dynasties industrielles, maintien de la classe dominante au pouvoir…). Le « nom », autre chose transmise de génération en génération, même si, à chaque génération, une moitié de l’arbre généalogique « tombe en désuétude » puisqu’il ne s’agit que de la transmission du nom de l’ancêtre le plus récent. Depuis 2003, la transmission du nom de famille ne fait plus aucune distinction entre le nom de la mère et celui du père. Sens plus figuré, pour des choses immatérielles : le laboureur et ses enfants… Le père transmet un héritage un peu abstrait : « travaillez, prenez de la peine », ce qui leur permettra de n’avoir besoin d’autre héritage que ce qu’ils récolteront de ce champ. La transmission des valeurs, des croyances… Héritage culturel d’une nation, gastronomie, folklore et tradition, coutumes, mythes, histoire, système de pensée… Héritage culturel à l’échelle de l’humanité toute entière, expérience de l’Histoire, sciences, art, philosophie, religion… Qu’est ce qui doit entrer dans cet héritage ? Comment le transmettre tout en le maintenant vivant et en évitant les réponses toutes faites « c’est comme ça » ? Mais également, tout en ne fermant pas la porte à la recherche, à la réflexion, au discernement…
Le débat et l’exposé : « Après toutes ces interrogations que chacun est en droit de se poser, Patric Chouzenoux invite les participants à débattre suivant un plan en deux parties : (1) l’aspect privé qui traitera de l’héritage ou des héritages, et (2) l’aspect public qui traitera de l’héritage culturel, environnemental, social. Il rappelle qu’il s’agit d’aborder quelques informations et notions significatives de l’héritage en tant que problématique de la société humaine et de débattre dans l’esprit de l’ARES ». (1) L’aspect privé : celui-ci suscite beaucoup de questions personnelles dans l’assistance. Patric Chouezenoux évoque l’importance historique de la source de l’héritage privé, « Avoir le bon numéro », connaître l’origine de son héritage. Il rappelle qu’il était de tradition, dans les familles, de faire hériter de façon privilégiée un enfant de la fratrie, en général l’aîné (droit d’ainesse) mais pas obligatoirement. Ce pouvait être « celui » qui restait au château et qui devait bénéficier de l’argent nécessaire à l’entretien de celui-ci, ou celui qui restait sur la propriété agricole et à qui la fratrie laissait tout. Mais l’aîné pouvait également être sacrifié pour exploiter la propriété agricole, tandis que ses frères et sœurs menaient leur vie comme bon leur semblait et qui, lors du partage, ne bénéficierait d’aucun avantage. Pour nous ramener au présent et illustrer ce propos, Patric Chouzenoux raconte de nombreuses situations qu’il a pu rencontrer et qui ne manquent pas d’être aussi cocasses que comiques, ou tristes car elles relatent l’explosion de sentiments, de frustrations, d’inégalités ou d’injustices familiales, si l’héritage n’est pas équitable ou considéré comme tel. Mais l’héritage est un garant de la propriété privée qui maintient la stabilité des conventions pour préserver l’équilibre d’un état. Les régimes sans propriété privée ne sont pas moins créateurs d’injustices. Il rappelle que l’équité est un principe de droit de norme supérieure et que, depuis 1791, le code civil impose l’égalité dans la fratrie, que les notaires ont parfois des difficultés à faire appliquer.
L’héritage renvoie dans un premier temps au deuil : « le mort saisit le vif », mais l’évolution de la société et de la durée de vie provoquent un déplacement de valeurs important. En effet, l’héritage peut être remplacé par le don de son vivant, et permet aux parents ou grands-parents d’aider leurs enfants ou petits-enfants en difficulté. Il précise que le législateur permet à un vivant de renoncer à un héritage au profit de ses enfants mais que la procédure est très lourde ». Les constatations : « Certains n’héritent pas. Certains héritages (ou successions) peuvent être déficitaires, d’où vérification que les dettes ne dépassent pas l’actif. Un conseil en cas d’excédent de passif : renoncer à la succession. Un exemple : certains héritent d’un site pollué avec obligation potentielle de dépolluer le site (histoire de la maison aux semelles de plomb). Pour la première fois, le droit public est entré dans le droit privé, et le « pollué héritier » peut devenir le payeur ».
Ensuite, un certain nombre de questions se posent… « Au-delà de l’héritage matériel, qu’allons-nous laisser à nos enfants en cette époque anthropocène où l’homme sort des limites de la variabilité naturelle et engage sa responsabilité au niveau de la planète ? Qu’allons-nous laisser en héritage culturel, spirituel, génétique ? L’éducation est-elle un héritage illégitime ou injuste ? Peut-on continuer à hériter de biens d’un autre temps, d’un autre mode de vie, devenus inutiles ? Peuvent-ils nous aider à prendre conscience de la valeur de ce que nous utilisons ? Il est à noter la peine que nous avons à nous séparer de biens lors du décès d’un de nos parents qui ont fait leur quotidien et le nôtre pendant un temps. Selon Lydia Flem : « Hériter de ses parents, c’est être confronté à la nécessité de faire leur deuil, d’entrer dans leur intimité, et de retracer à travers les objets qu’ils ont possédés, leur histoire, et sa propre enfance. » Il ressort que l’héritage immatériel permet de progresser (en médecine, en science…), que l’héritage culturel est inaliénable, que l’homme veut être éternel et qu’il a besoin de transmettre pour continuer à vivre, à laisser une trace ».
« Nous sommes tous des héritiers et nous avons tous des héritiers, comme dans la nature où la mère transmet à l’enfant, comme dans la transmission de la langue, de l’éducation, du patrimoine culturel… Il est noté que la transmission des « règles sociales » (ex : le droit des femmes) est réévaluée au fil des générations, que chaque naissance est un monde nouveau. Mais la transmission des valeurs d’une société se fait sans tenir compte du récepteur, et qu’un même héritage n’implique pas forcément la même valeur ». Une dernière pensée referme la conférence de M. Chouzenoux : « Avant la révolution de 1799 : « on appartient à une terre ». Après la révolution : « une terre nous appartient » ». Françoise Chauvière
– Les prochaines réunions de l’ARES : 24/02 « Orthodoxie » animée par le Père Élie ; 17/03 « Nature, éducation, enseignements » ; 13/04 « Vivre dans une société multi religieuse » animée par Mgr Albert Rouet ; 19/05 « La joie de vieillir » animée par Geneviève Demoures, médecin gériatre…