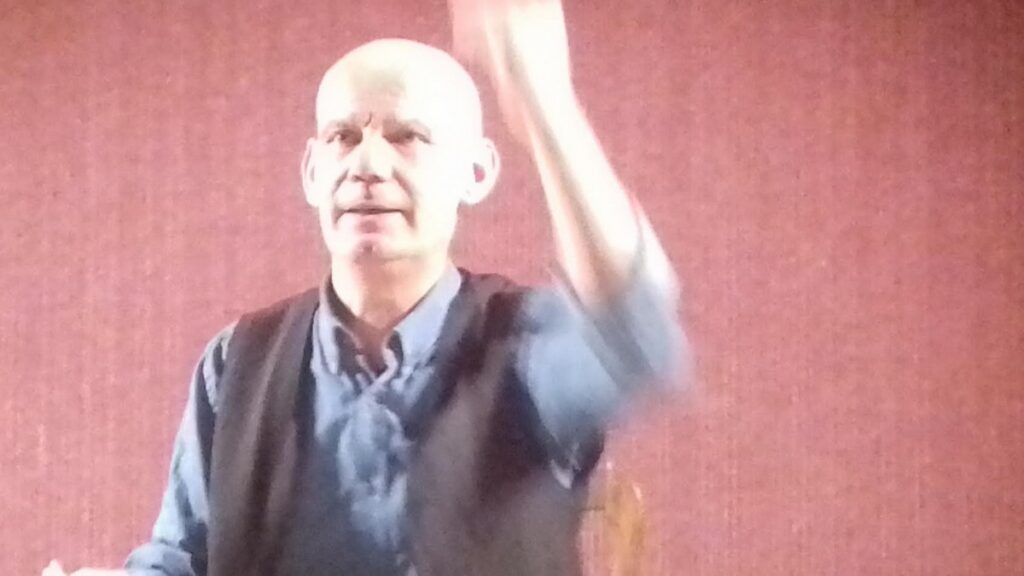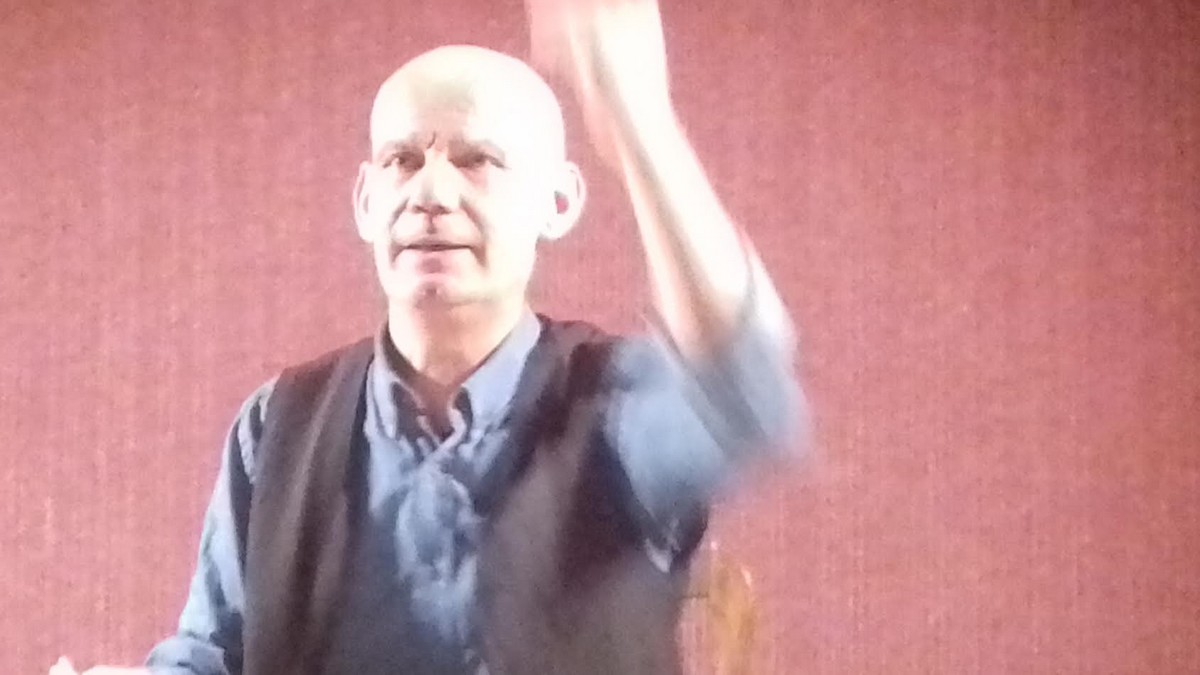 L’étrange lecture au programme de la salle socio-culturelle du Lardin Saint-Lazare, vendredi 27 janvier 2017, a été un moment d’une rare qualité, salué par un public nombreux, dont l’écoute silencieuse et attentive manifestait combien la force et la beauté littéraire de l’oeuvre de Siegfried Lenz « La leçon d’allemand », touchait chacun en profondeur. En présence d’Olivier Rouzier, adjoint au maire du Lardin, qui a présenté le spectacle en invitant le public à partager ensuite un verre de l’amitié, et de Sandrine Pantaleao, directrice de la Bibliothèque Départementale de Prêt, qui a rappelé que l’événement avait pour partenaires la Médiathèque Pierre Fanlac de Périgueux et le réseau de l’agglomération bergeracoise, cette manifestation initiée par Vincent Fournier, il y a déjà quatorze ans, tient toutes ses promesses de démocratisation culturelle avec un constant souci de qualité comme en témoigne le choix des oeuvres proposées. Rappelons que Vincent Fournier, fondateur des « Etranges lectures », est lui-même professeur émérite à l’Université de Bordeaux et traducteur d’auteurs suédois ou norvégiens comme Nikolaj Frobenius chez Actes Sud, passion qui est sans doute à l’origine de son projet de faire connaître des oeuvres écrites en langues étrangères.
L’étrange lecture au programme de la salle socio-culturelle du Lardin Saint-Lazare, vendredi 27 janvier 2017, a été un moment d’une rare qualité, salué par un public nombreux, dont l’écoute silencieuse et attentive manifestait combien la force et la beauté littéraire de l’oeuvre de Siegfried Lenz « La leçon d’allemand », touchait chacun en profondeur. En présence d’Olivier Rouzier, adjoint au maire du Lardin, qui a présenté le spectacle en invitant le public à partager ensuite un verre de l’amitié, et de Sandrine Pantaleao, directrice de la Bibliothèque Départementale de Prêt, qui a rappelé que l’événement avait pour partenaires la Médiathèque Pierre Fanlac de Périgueux et le réseau de l’agglomération bergeracoise, cette manifestation initiée par Vincent Fournier, il y a déjà quatorze ans, tient toutes ses promesses de démocratisation culturelle avec un constant souci de qualité comme en témoigne le choix des oeuvres proposées. Rappelons que Vincent Fournier, fondateur des « Etranges lectures », est lui-même professeur émérite à l’Université de Bordeaux et traducteur d’auteurs suédois ou norvégiens comme Nikolaj Frobenius chez Actes Sud, passion qui est sans doute à l’origine de son projet de faire connaître des oeuvres écrites en langues étrangères.
Avec le choix de « La leçon d’allemand » de Siegfried Lenz, paru en 1968, Etranges lectures nous a proposé de revenir à cette époque où quelque chose vient rompre le lourd silence de l’Allemagne de K. Adenauer. Celui-ci meurt en 1967 et la jeunesse qui a ressenti l’étouffante culpabilité larvée des années de reconstruction à l’Ouest, demande des comptes à ses aînés sur les temps sombres du nazisme. Ce livre est le premier ouvrage qui jette un pavé dans la mare et dont le retentissement mondial porte avec lui tout un travail de questionnement, un cheminement des consciences dont s’est particulièrement investie la littérature allemande avec le « Gruppe 47 » où l’on retrouve Günter Grass, Heinrich Böll, Uwe Johnson, Martin Walser aux côtés de Siegfried Lenz puis de Bernhard Schlink…
De manière à la fois vivante et brillante, Claire Lussac François, professeure agrégée d’allemand, qui remplaçait Christine Sassiat empêchée, a brièvement présenté l’auteur, puis elle a su conduire les auditeurs au sein du cadre et des relations entre les protagonistes de « La leçon d’allemand », son roman phare, dont l’acteur Thierry Lefever allait lire les plus beaux extraits. Né en 1926 en Prusse orientale, lui-même enrôlé à 13 ans dans les Jeunesses hitlériennes, puis incorporé dans la marine en 43 ce qui l’oblige à interrompre ses études, Siegfried Lenz se réfugie au Danemark après le naufrage de son navire. Fait prisonnier par les britanniques puis libéré à la fin de la guerre, il s’installera à à Hambourg, où il est décédé le 7 octobre 2014. Employé comme pigiste au journal Die Welt, il écrivit son premier roman à l’âge de 25 ans, 13 autres suivront, plus de nombreuses publications. Il avait 44 ans quand il publia « La leçon d’allemand », cette oeuvre est donc le fruit du temps nécessaire à la réémergence lente des souvenirs de son père et de sa mère, dont il fut tôt séparé, et dont il retrouve les traits sous les personnages du roman, pour penser, en « pédagogue secret » de l’allemagne à venir, « la banalité du mal » qui selon Hannah Arendt, a rendu possible cette terrible époque.
Siggi Jepsen, à l’âge de 10 ans, se retrouve enfermé dans une maison de correction pour jeunes délinquants située sur une île au large de Hambourg. Il est puni pour avoir rendu copie blanche à une rédaction sur « Les joies du devoir ». Alors qu’il reste encore « sec » durant cinq jours, incapable d’écrire et toujours distrait par la vue de sa fenêtre et les méandres de l’Elbe, le passé remonte lentement dans son esprit comme l’Elbe remonte jusqu’à son embouchure… Ce fleuve, qui figure, selon les mots de Claire Lussac, « le cordon ombilical du roman », le conduit jusqu’au village de Rugbül, à l’extrême Nord de l’Allemagne, dans le Schleswig-Holstein… C’est alors que l’écriture vient et que devant le flot de ses souvenirs d’enfance, il « met sa punition sous clefs » et passe un an à rédiger les 600 pages qui viennent sous sa plume. Il retrouve la manière dont son père, Ole Jepsen brigadier de police responsable du poste de Rugbül se chargeait avec zèle de transmettre au peintre Max Ludwig Nansen l’ordre nazi d’interdiction de peindre, le harcelant de ses visites afin qu’il le respecte. Il réentend les propos de sa mère faisant chorus avec l’idée nazie qui voyait dans l’art expressionniste un art « dégénéré » : « Quand on voit le genre d’humanité qu’il peint, ces visages verts, ces yeux mongols, ces corps difformes, toutes ces choses qui viennent d’ailleurs : on sent qu’il est malade. Un visage allemand, on n’en rencontre pas chez lui « … De quoi donc ont-ils peur ? Pourquoi cette censure ?« A cause des couleurs « , dit le peintre, « car elles ont toujours quelque chose à raconter, il leur arrive même d’avoir des opinions ». Restituant au plan littéraire leur énergie subversive, Siegfied Lenz laisse éclater tout ce qu’elles ont à dire, qui fait voler en éclats la chape de plomb du silence coupable et complice où restait engluée la génération de ses parents.
Comme l’a rappelé Claire Lussac François, l’auteur s’est inspiré du peintre expressionniste Emil Hansen (1867- 1956), alias Emil Nolde dont l’oeuvre fut censurée par les nazis et qui prit le nom de son territoire natal. Comme lui, Nansen ne peut réprimer en lui la peinture, aussi essentielle à sa vie que la respiration, comme seul semble le comprendre l’enfant. Il cache ses tableaux que le brigadier parvient à dénicher, et se lance dans un cycle de « peintures invisibles » puisqu’elles n’ont pas le droit d’exister…
Siegfried Lenz transforme la « punition » de Siggi Jepsen en une analyse profonde de l’obéissance aveugle que nombre d’allemands ont prise pour le sens même du devoir, cette « idée fixe », cette « véritable maladie »qui a permis l’accomplissement absurde d’une idéologie nihiliste, raciste et meurtrière. Affirmant avec force l’essentiel enracinement de l’art dans la vie, rebelle à tout ce qui frappe celle-ci d' »alignement », l’auteur fait dire à Nansen dont l’enfant avait secrètement pris le parti : « On est peintre ou on ne l’est pas, on peint toujours ou alors on ne peint jamais. Peut-on interdire à quelqu’un de rêver ? ». Il ne peut y avoir qu’un devoir fantoche et criminel dans le respect de tels interdits arbitraires. Qui mérite donc vraiment la punition ? Qui a commis la vraie faute ? Le fils ou le père ? Est-ce au fils de porter et de payer toujours la culpabilité non assumée de son père ? Ce sont d’aussi cruciales questions que cette oeuvre puissante présente à nos esprits avec ce rare génie d’accéder à la plus haute réflexion morale sans aucun moralisme.
L’acteur Thierry Lefever (photo), de la compagnie Raoul et Rita, a été en tous points la voix et l’esprit de ce texte qu’il a servi avec beaucoup de force et d’humilité, désireux avant tout de le faire partager largement, jusque dans les prisons, comme à la maison d’arrêt de Périgueux où il l’a lu dans le cadre du SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation). Il a été chaleureusement applaudi par le public, invité à échanger à la fin du spectacle autour de gâteaux et boissons offerts par la mairie du Lardin, rejoint par les élus Laurent Delage, Dominique Bousquet et Francine Bourra qui ont réussi à se libérer un peu entre d’autres événements. S.D.
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer